![]()
La photographie en couleurs est fondée sur le principe selon lequel trois couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu, suffisent pour reproduire toutes les autres. Ce mélange est dit "additif". Les procédés photographiques additifs sont rares et, de nos jours, la plupart des émulsions reposent sur un mélange "soustractif" des couleurs. Dans les procédés soustractifs trichromes, ce sont les couleurs complémentaires des trois précédentes qui sont utilisées : jaune, magenta et cyan. Les films comportent, superposées, trois images monochromes, chacune d'une des couleurs citées juste avant. Lors de la projection d'une diapositive, ces couches agissent comme des filtres et permettent la reproduction des couleurs par soustraction des couleurs complémentaires contenues dans la lumière blanche émise par la lampe. Le premier procédé trichrome a été réalisé, indépendamment l'un de l'autre, par Ducos du Hauron et Cros en 1869. Le premier à être commercialisé fut le Kodachrome, en 1935 aux Etats-Unis. Il fut suivi en 1936 par l'Agfacolor en Allemagne. Dans ces émulsions trichromes, les colorants se forment automatiquement grâce à la présence de coupleurs. Ces composés, lors du développement chromogène, réagissent avec les produits d'oxydation pour engendrer un colorant autour des grains d'argent métal développés auparavant. Le développement des films en couleurs comporte donc une phase de développemnt noir et blanc, qui produit l'image argentique, une phase de développemnt chromogène, qui produit les colorants, et une phase de blanchiment-fixage, pour éliminer les grains d'argent et stabiliser l'image.
L'émulsion noir et blanc est constituée d'un support sur lequel est coulée une couche de gélatine contenant des cristaux de sels d'argent en suspension. Sa sensibilité à la lumière est relativement faible. On peut l'augmenter par l'adjonction de produits appropriés. Cette sensibilité est exprimée en degrés ISO (équivalent à ASA ou DIN). Sous l'action de la lumière, les cristaux d'halogénure d'argent ont subi une transformation et peuvent être réduits par des agents oxydants. L'immersion du film dans le bain révélateur rend l'image latente visible, constituée par de l'argent réduit. Après rincage, l'immersion dans le bain de fixage élimine les sels d'argent inutilisés. Aprés traitement, le tirage s'effectue sur couche sensible (papier, plaque ou film) par exposition de durée déterminée à la lumière blanche, à travers le négatif, positionné dans un agrandisseur. L'épreuve obtenue est traitée comme les négatifs, dans des bains similaires.
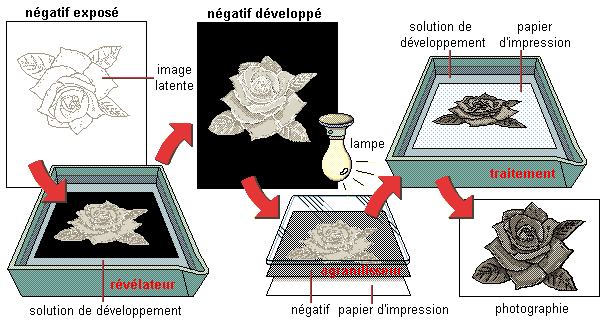
Les procédés argentiques constituent la majorité des procédés photographiques modernes. Ils existent depuis l'invention de la photographie. En ordre de leur apparition historique, les plus connus sont :
Voir également les détails sur le procédé argentique.
Les procédés dits "nobles", ou alternatifs, se basent sur des réactions chimiques comparables à celles de la photographie argentique conventionnelle. Les procédés photographiques peuvent, du point de vue chimique, se classer en trois groupes: les procédés basés sur l'emploi de sels d'argent, les procédés employant des sels de fer et ceux basés sur l'emploi des sels de chrome.
Procédés sur l'emploi des sels de fer :